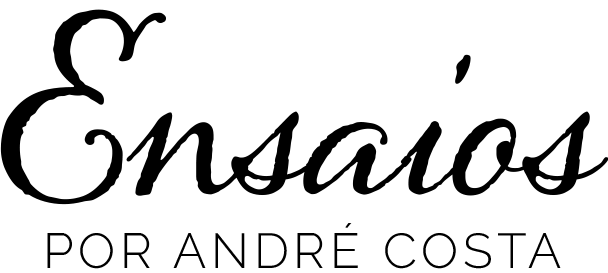Commentaires particuliers au n° 1505 du Catéchisme de l’Église catholique
Introduction
Les gestes concrets du Christ — toucher, insuffler, oindre, mêler la boue, laver et bénir — ne sont pas de simples mises en scène pieuses. Ils révèlent une théologie profonde, enracinée dans la structure même du réel et dans l’histoire du salut. En Dieu fait homme, la grâce invisible se communique par des moyens visibles, et le monde sensible devient voie d’accès au divin.
Cette dynamique, qui unit matière et esprit, ne manifeste pas seulement le mystère de l’Incarnation ; elle réalise aussi les principes fondamentaux de la métaphysique aristotélicienne : matière et forme, acte et puissance. En assumant la matière, le Verbe incarné la rachète et la transforme en instrument de la grâce ; l’argile, l’eau, le toucher et la parole deviennent des véhicules de la présence divine.
Or, cette manière concrète d’agir de Dieu se déploie déjà dès l’Ancien Testament : le peuple d’Israël fut éduqué à reconnaître l’invisible au moyen de signes matériels. Le serpent d’airain dressé au désert (Nb 21,8-9) guérissait ceux qui le regardaient ; l’Arche d’Alliance, faite de bois et d’or, devenait le trône de la présence divine (Ex 25,10-22) ; la manne et la nuée étaient des signes tangibles de la sollicitude de Dieu durant l’Exode ; les pierres du Jourdain, retirées du lit du fleuve, servaient de mémorial au passage du peuple (Jos 4,6-7).
Ces symboles n’étaient pas de l’idolâtrie, mais une pédagogie sacrée : ils indiquaient que le Dieu d’Israël, tout en demeurant transcendant, se laisse trouver dans le concret. Le judaïsme a ainsi façonné une véritable « physique symbolique », où la matière est médiation du mystère. La guérison, le sacrifice, l’onction et la bénédiction ont toujours impliqué des gestes visibles et corporels, expression de l’alliance entre le ciel et la terre.
C’est dans cet horizon que l’on comprend pleinement l’agir du Christ. Le Verbe incarné assume et accomplit ce langage ancestral, révélant que tous les signes de l’Ancienne Alliance — le serpent, l’arche, la manne et le Temple — trouvent en Lui leur plénitude. Il est la Présence réelle de Dieu dans le monde sensible, la substance derrière tous les signes. Ainsi, chaque geste de l’Évangile — le toucher du lépreux, la boue sur les yeux, le souffle sur les disciples — n’est pas un simple miracle physique, mais l’accomplissement d’une pédagogie divine tout entière : Dieu se laisse toucher pour que l’homme réapprenne à voir l’invisible.
Le motif théologique : l’Incarnation
La théologie chrétienne naît de la confession de Jean : « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14). En Christ, le Logos éternel entre dans l’histoire, assumant la matière pour la racheter. Comme l’observe saint Augustin (Traités sur l’Évangile de Jean, 80,3) :
« Le Verbe s’est fait chair afin que, par la chair, il nous soit possible de toucher le Verbe. Les signes visibles sont les paroles du Verbe devenues visibles. »
L’usage d’éléments matériels dans les miracles de Jésus (la salive qui ouvre les yeux de l’aveugle, le toucher qui purifie le lépreux, l’eau changée en vin) révèle que la matière participe à l’économie du salut. La grâce n’est pas une idée abstraite, mais une énergie divine qui imprègne le réel. Ainsi, le Christ incarné n’enseigne pas seulement des vérités spirituelles : il touche, transforme et sanctifie la création, montrant que le monde sensible peut être sacrement de l’invisible.
Cependant, cette pédagogie de l’Incarnation s’enracine dans un drame antérieur : l’homme, blessé par le péché originel, a perdu la capacité de percevoir le spirituel. Le regard de l’âme, qui autrefois contemplait Dieu dans la transparence de la création, est devenu opaque. Le péché n’a pas détruit la soif de Dieu, mais l’a dévoyée ; et l’homme, se tournant vers le monde, a perdu le chemin du retour.
Alors Dieu, dans son infinie condescendance, descend à la rencontre de l’homme. L’Incarnation est le mouvement inverse de la Chute : le Ciel qui cherche la Terre, le Père qui sort à la recherche de ses enfants dispersés, le Berger qui va après la brebis perdue. L’invisible devient visible non seulement pour être contemplé, mais pour reconstruire le pont brisé entre l’humain et le divin.
Comme l’enseigne saint Jean Chrysostome (Homélies sur Matthieu, 25,2) :
« Le Seigneur se sert du sensible pour conduire au spirituel, car notre faiblesse ne peut supporter les choses divines si elle ne les voit de ses yeux. »
Dans les Évangiles, Jésus fait du sensible la porte de la grâce : le sourd est guéri lorsqu’Il touche ses oreilles ; le paralytique, lorsqu’il entend la parole d’ordre ; l’aveugle, lorsque la boue touche ses yeux. Chaque geste est une catéchèse incarnée. Cette pédagogie divine traduit une anthropologie intégrale : l’homme est corps et âme, et le chemin vers l’esprit passe par le corps.
En s’incarnant, Dieu nous parle dans le seul langage que nous puissions pleinement comprendre : celui de l’expérience sensible, où le toucher, le regard et la parole deviennent instruments de salut.
L’anticipation sacramentelle
Les gestes de guérison du Christ ne sont pas de simples signes isolés ; ils sont des proto-sacrements, c’est-à-dire des anticipations de la manière dont Il continuera d’agir dans l’Église à travers les siècles. La logique qui les soutient est la même que celle des sacrements : matière et forme, acte sensible et grâce invisible.
L’eau du baptême, l’huile de l’onction, le pain et le vin de l’Eucharistie sont des prolongements de l’Incarnation dans le temps, des instruments par lesquels le Verbe incarné continue de toucher et de transformer l’humanité.
Saint Thomas d’Aquin explique cette structure avec une clarté magistrale :
« Il convient à la condition humaine que la grâce divine nous soit conférée par des signes sensibles, car l’homme est conduit des réalités corporelles aux réalités spirituelles. »
(Somme Théologique, III, q.61, a.1)
Dieu, par conséquent, ne méprise pas la matière ; Il l’assume comme instrument. Le Christ guérit par le toucher, et l’Église, poursuivant sa mission, administre la grâce au moyen de réalités visibles : l’argile, l’huile, l’eau, le pain et le vin — réalités que la parole divine transforme en véhicules de vie surnaturelle.
Chaque geste miraculeux de Jésus est donc une prophétie visible de la vie sacramentelle, une anticipation concrète de la manière dont Dieu a choisi de demeurer présent dans le monde.
Le sens théologique des proto-sacrements
Le terme proto-sacrement (protosacramentum) n’appartient pas au vocabulaire dogmatique de l’Église, mais au langage théologique postérieur qui a cherché à décrire la dynamique sacramentelle déjà à l’œuvre dans les gestes du Christ.
Au sens précis, les proto-sacrements sont les actes et les signes accomplis par Jésus qui préfigurent, instituent et annoncent le mode sacramentel de la grâce. Ils ne sont pas encore les sacrements dans leur forme pleine, conférés par l’Église après Pâques, mais des actes inauguraux — des signes vivants de la nouvelle économie divine.
Dans les miracles du Christ se manifeste déjà la logique sacramentelle de la Nouvelle Alliance : l’union entre corps et esprit, matière et grâce, geste et puissance invisible. Lorsque l’Évangile raconte que le Seigneur guérit l’aveugle avec de la boue et de la salive (Jn 9,6), nous entrevoyons le baptême, où l’eau purifie et illumine. Lorsqu’il touche le paralytique et prononce la parole de pardon (Mc 2,5), il anticipe le sacrement de la Réconciliation, dans lequel le corps et la parole deviennent instruments de guérison spirituelle. La multiplication des pains et la Cène dévoilent par avance le mystère de l’Eucharistie, tandis que l’onction des malades à l’huile (Mc 6,13) annonce le sacrement de l’Onction des malades.
Chaque geste du Christ est ainsi semence d’un sacrement futur, révélation anticipée de la manière dont la grâce divine deviendrait accessible aux sens.
La notion de proto-sacrements surgit dans la théologie scolastique médiévale, lorsque les maîtres chrétiens ont cherché à distinguer les signes de l’Ancienne Loi et les sacrements de la Nouvelle Alliance.
Parmi les pionniers figure Hugues de Saint-Victor (XIIe s.) qui, dans le De Sacramentis Christianae Fidei (I, 9,2), offre la définition qui marquera toute la tradition ultérieure :
« Nous appelons sacrement toute célébration corporelle qui représente une grâce spirituelle sous le voile du mystère. »
Bien que saint Hugues n’emploie pas le préfixe proto-, il décrit précisément les gestes du Christ comme des fondements visibles de la nouvelle économie de la grâce, anticipant ce que les théologiens nommeront plus tard proto-sacrements.
Cette intuition atteint sa maturité chez saint Thomas d’Aquin qui, sans employer le terme, en développe pleinement le concept. Dans la Somme Théologique (III, q.60-65), le Docteur angélique enseigne que « tous les sacrements procèdent du Christ incarné, principe de toute sanctification » (ST III, q.62, a.5), et ajoute que « dans le Christ, les sacrements existaient en figure avant d’être transmis à l’Église » (ST III, q.64, a.3 ad 2).
Avant d’être des rites et des institutions ecclésiales, les sacrements ont existé comme gestes réels du Verbe fait chair. Avant d’être administrés par l’Église, ils ont été vécus et signifiés par le Christ dans la rencontre directe entre l’homme et Dieu.
Aux XXe et XXIe siècles, cette ligne a été reprise par de grands théologiens tels qu’Henri de Lubac, Yves Congar et Karl Rahner, qui ont réinterprété le concept en clé christologique. Henri de Lubac, dans Corpus Mysticum (1944), affirme que le Christ est le « sacrement primordial » de Dieu, parce qu’en Lui « l’invisible devient visible et la grâce se communique en plénitude ». Karl Rahner, dans Schriften zur Theologie (vol. 4, 1960), reprend la même pensée avec le terme allemand Ur-Sakrament :
« Le Christ est le sacrement primordial de la rencontre entre Dieu et l’homme. »
Ces formulations distinguent deux niveaux complémentaires : le Christ comme Proto-sacrement absolu — le sacrement originel, présence visible du Dieu lui-même dans le monde ; et les gestes du Christ comme proto-sacrements particuliers — signes inauguraux qui préfigurent les sept sacrements et en révèlent la logique.
Ainsi, le mystère sacramentel ne naît pas seulement après Pâques ; il fleurit déjà dans la vie terrestre de Jésus, dans les paroles qui pardonnent, dans les touchers qui guérissent, dans les gestes qui communiquent la grâce.
La boue, l’eau, l’huile, le pain et le vin, éléments simples de la création, deviennent, entre ses mains, des instruments de la rencontre entre le divin et l’humain. En synthèse, le concept de proto-sacrement exprime la conviction que l’action sacramentelle de l’Église est la continuation historique de l’action incarnée du Christ. La même puissance qui a touché les yeux de l’aveugle et purifié le lépreux demeure vivante dans les sacrements qui aujourd’hui touchent, lavent, pardonnent et nourrissent les fidèles.
L’Incarnation, par conséquent, n’est pas seulement le commencement du salut : elle est le principe sacramentel de l’histoire.
La dimension personnelle du toucher
Parmi tous les gestes du Christ, le toucher occupe une place singulière. C’est le geste de la proximité divine, le sacrement de la compassion incarnée. Dans les Évangiles, Jésus guérit rarement à distance ; il touche le lépreux (Mc 1,41), touche les yeux de l’aveugle (Mt 9,29), prend la fille de Jaïre par la main (Mc 5,41), impose les mains aux malades (Lc 4,40). Ces gestes ne sont pas de simples véhicules de puissance, mais des expressions de l’amour qui devient contact : la grâce qui n’a pas peur de s’approcher de la misère.
Dans la société juive du premier siècle, le toucher était strictement régi par les lois de pureté rituelle. Toucher un lépreux, un cadavre ou une femme atteinte de pertes rendait impur (Lv 13-15). Ces normes n’étaient pas seulement sanitaires, mais symboliques : elles démarquaient la distance entre le sacré et le profane.
C’est pourquoi le toucher du Christ est théologiquement révolutionnaire : il inverse la logique de l’impureté, montrant que la sainteté divine ne se contamine pas, mais purifie ce qu’elle touche. Comme l’enseigne saint Grégoire le Grand (Homélies sur les Évangiles, 32,1) :
« Le Seigneur toucha le lépreux, et le lépreux fut purifié ; car la pureté vint à l’impur, et l’impureté ne souilla pas la pureté. »
Le toucher du Christ est ainsi une théologie en acte. Il rend visible ce que la doctrine exprimera par des mots : la grâce est une réalité concrète, qui passe d’un corps à l’autre, communiquant la vie. Chaque miracle est une petite Pentecôte, une irradiation de l’Esprit à travers l’humanité de Jésus. Son corps devient le sacrement de la présence divine, et son toucher, le prolongement visible de l’amour trinitaire.
Cependant, ce geste n’est pas impersonnel. Le miracle, avant d’être un acte de puissance, est une rencontre. Jésus ne guérit pas des foules anonymes ; il s’approche de chacun par son nom, il regarde, parle, touche. Le contact physique rétablit le contact spirituel : l’homme est à nouveau vu, reconnu, aimé.
Chez le lépreux, le toucher restitue le droit d’être touché ; chez la femme malade, il restaure la communion avec la communauté et avec Dieu. La guérison est plus que biologique : c’est une rédemption relationnelle, la reconstitution de l’image de Dieu en l’homme.
Cette dimension personnelle explique pourquoi, dans les Évangiles, la foi est toujours demandée. Jésus touche, mais exige une correspondance intérieure : « Croyez-vous que je puis faire cela ? » (Mt 9,28). Le toucher divin n’annule pas la liberté humaine ; il l’éveille, et la grâce n’agit pas sans le consentement de l’amour.
Comme l’enseigne saint Jean Chrysostome, « Il touche pour guérir et il interroge pour susciter la foi, car la grâce n’agit pas sans le consentement de l’amour humain. »
La théologie reconnaît dans ce dynamisme une pédagogie de l’Incarnation. Le Christ agit par les sens afin de reconduire l’homme, qui avait perdu le contact avec le spirituel, à la communion avec l’invisible. Dans les miracles, cette pédagogie est immédiate ; dans les sacrements, elle devient permanente et ecclésiale.
Le même toucher qui a guéri le lépreux se poursuit dans l’imposition des mains de la Confirmation et de l’Ordre ; la même salive qui a ouvert les yeux de l’aveugle renaît dans l’eau du baptême ; le même corps qui a nourri les disciples à la Cène continue de nourrir les fidèles dans l’Eucharistie.
Le toucher est donc le symbole suprême de l’Incarnation en acte : Dieu ne sauve pas de loin ; il touche l’homme pour que l’homme touche à nouveau Dieu. La distance entre le Créateur et la créature est vaincue par la main qui se tend, par la chair qui communique la grâce. Dans le toucher du Christ, la théologie se fait chair et la chair devient théologie.
La métaphysique aristotélicienne et une théologie de la matière
La philosophie d’Aristote fournit la structure rationnelle qui soutient l’intelligence chrétienne de cette pédagogie divine. Pour lui, toute réalité corporelle est composée de matière (hylè) et de forme (morphè) : la matière est puissance — ce qui peut advenir — et la forme est acte — ce qui actualise et donne l’être.
Dans les miracles, le Christ agit précisément sur la matière — le corps malade, l’eau, la boue — par sa parole et son geste. La parole divine est l’acte qui actualise la puissance latente dans la créature. L’aveugle peut voir (puissance), et le toucher du Christ le fait voir (acte). Le sourd peut entendre, et la parole le fait entendre. Le miracle est donc une actualisation métaphysique : la matière créée atteint sa perfection lorsqu’elle est touchée par la Forme des formes, le Verbe incarné.
Ainsi, dans la perspective aristotélicienne, Dieu est Acte pur (actus purus), sans potentialité, cause finale de tout. En Christ, Thomas d’Aquin reconnaît ce même Acte pur agissant dans l’histoire. Le Logos, Forme subsistante, touche la matière et l’élève à sa fin :
« De même que la nature agit par des causes secondes visibles, de même Dieu agit par des causes sensibles pour nous élever à la cause première invisible. »
(Somme Théologique, III, q.61, a.1, ad 2)
Chaque miracle est alors une épiphanie métaphysique : la puissance de la créature est actualisée par l’Acte pur de Dieu. Le Christ est la Forme qui informe et transforme la matière, révélant que la création est sacramentelle dans sa structure même.
Le symbolisme sensible dans le judaïsme
La culture juive du temps de Jésus possédait déjà une profonde conscience de l’efficacité symbolique de la matière. Les rabbins parlaient de la shekinah, la présence de Dieu qui « habite » le sensible. Chaque geste rituel était une médiation visible de l’invisible : l’eau des ablutions (purification), l’huile de l’onction (autorité et guérison), le sang de l’agneau (alliance et expiation).
Le Talmud (Berakhot 35a) enseigne :
« Il n’est pas permis à l’homme de jouir de ce monde sans bénédiction ; qui le fait est comme s’il dérobait à Dieu. »
Autrement dit, le matériel était perçu comme sacré en puissance : il requérait parole, geste et bénédiction pour révéler sa finalité divine.
Jésus agit dans cette logique : il n’abroge pas les signes, mais les porte à leur plénitude. Il est le vrai Rabbi qui enseigne par les mains, la voix et la matière. Ses miracles ne rompent pas avec le judaïsme ; ils l’accomplissent en clé christologique, car la physique symbolique des rabbins trouve en Christ son point de convergence : Dieu qui se laisse toucher.
Maladie, malédiction et restauration : le sens public de la guérison
Dans l’imaginaire religieux d’Israël, la maladie n’était pas seulement un état physique, mais un signe de désordre spirituel. L’Ancien Testament reliait fréquemment la maladie à la faute ou à la malédiction : le lépreux était considéré comme « impur » (Lv 13,45-46) ; l’aveugle ou le paralytique étaient empêchés d’entrer dans le Temple (2 S 5,8) ; et la souffrance était lue comme un châtiment divin.
La littérature rabbinique renforce cette mentalité. Dans le Talmud (Nedarim 41a), on lit :
« Le malade est comme celui qui a tout perdu ; la santé est le plus grand don de Dieu. »
Et dans Shabbat 55a :
« Il n’est pas de mort sans péché, ni de souffrance sans iniquité. »
Être malade revenait donc à être maudit et socialement mis à part. La guérison, pour sa part, n’était pas seulement un rétablissement biologique, mais une réintégration religieuse et sociale. Lorsque Jésus guérit, il bénit publiquement celui qui, auparavant, était considéré comme exclu de l’alliance. La restauration physique devient signe visible de la restauration spirituelle et communautaire.
Cette compréhension explique l’intensité publique de nombreux miracles : le lépreux est envoyé au prêtre « en témoignage pour eux » (Mc 1,44) ; le paralytique est guéri « aux yeux de tous » (Lc 5,25-26) ; et l’aveugle de naissance est rétabli dans la communauté du culte (Jn 9,7), entre autres.
Chaque guérison est donc un acte liturgique de réconciliation, dans lequel le « maudit » est déclaré béni. En guérissant, le Christ subvertit la théologie de la rétribution alors dominante : il montre que la maladie n’est pas un châtiment, mais une occasion de manifester la gloire de Dieu (Jn 9,3). Le miracle cesse d’être une démonstration de puissance pour devenir un rite d’inclusion, un geste sacramentel qui anticipe le pardon.
Conclusion : la logique de l’Incarnation
L’agir de Jésus révèle que Dieu ne méprise pas la matière, mais qu’il l’assume et la sanctifie. Les miracles du Christ sont des actes où la métaphysique devient pastorale et où l’Incarnation se traduit en pédagogie du sensible : le Verbe fait chair touche la création et l’élève à la grâce. Dans la perspective aristotélico-thomiste, l’Acte pur actualise les puissances de la création ; dans la perspective juive, le Messie rétablit publiquement le maudit, transformant la honte en bénédiction.
Ainsi, les gestes de Jésus — toucher, insuffler, laver et oindre — ne guérissent pas seulement des corps : ils reconstituent la communion. L’invisible devient concret, la philosophie se fait chair et l’histoire devient sacrement.
Comme l’écrit saint Thomas :
« Le Sauveur guérissait par des gestes et des paroles pour montrer que, de même que le Verbe s’est fait chair, de même la grâce devient visible dans la chair des sacrements. » (ST III, q.61, a.1, ad 3)
Sources principales
Saint Augustin, In Ioannis Evangelium Tractatus, 80,3.
Saint Jean Chrysostome, Homiliae in Matthaeum, 25,2.
Saint Grégoire le Grand, Homiliae in Evangelia, 32,1.
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, III, q.60-61.
Aristote, Métaphysique, Livres VII-IX ; De Anima, II,1.
Talmud de Babylone, Berakhot 35a ; Shabbat 104b.
Philon d’Alexandrie, De Vita Mosis, II, 145-147.
Hugues de Saint-Victor, De Sacramentis Christianae Fidei, I, 9,2.
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, III, q.60-65.
Henri de Lubac, Corpus Mysticum : L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, 1944.
Karl Rahner, Schriften zur Theologie, vol. 4, « Der Christ als Ur-Sakrament », 1960.
Yves Congar, Mystère du peuple de Dieu, 1953.