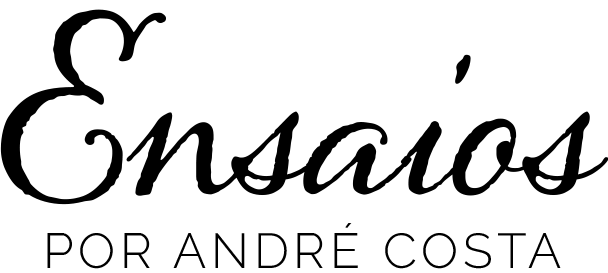Lorsqu’on parle des grandes hérésies des premiers siècles chrétiens, on imagine généralement des groupes marginaux, enfermés dans des cercles obscurs, éloignés de la vie ordinaire des communautés. Le cas du valentinianisme brise ce schéma. Entre les IIᵉ et IIIᵉ siècles, le système élaboré par Valentin, l’un des maîtres gnostiques les plus sophistiqués, s’est infiltré au cœur même de l’Église, a attiré des élites cultivées, a produit une littérature de très haut niveau et a presque constitué, en certains lieux, une alternative interne viable au christianisme naissant. La réaction de l’Église fut ferme, mais non immédiate. Pendant des décennies, évêques et fidèles durent affronter le malaise de constater que l’adversaire ne venait pas de l’extérieur : il parlait la même langue, lisait les mêmes Écritures et fréquentait les mêmes assemblées.
Qui était Valentin, le presque-évêque de Rome
Valentin naît vers l’an 100 apr. J.-C. à Alexandrie, ville façonnée par la culture hellénistique depuis Alexandre le Grand et l’un des principaux centres intellectuels de la Méditerranée. S’y croisaient philosophie platonicienne, traditions juives, courants stoïciens et premiers cercles chrétiens urbains. C’était un milieu de bibliothèques, d’écoles de rhétorique et de débats sur le sens des Écritures à la lumière de la philosophie grecque, ce même creuset culturel qui formera plus tard Clément et Origène.
Dans ce contexte, Valentin reçoit une formation raffinée. Sa conversion au christianisme a probablement lieu encore en Égypte, au milieu de communautés urbaines habituées à dialoguer avec la paideia hellénistique. Des auteurs anciens suggèrent qu’il eut des contacts avec des maîtres liés à la tradition de Philon d’Alexandrie et avec des cercles qui déboucheront plus tard sur l’École catéchétique. Il ne s’agit pas d’imaginer un “séminaire” au sens formel, mais un environnement où lire la Bible avec des catégories philosophiques, surtout platoniciennes, allait presque de soi.
Aux environs de 136–140 apr. J.-C., Valentin se rend à Rome. Il ne vient pas de Judée et n’est pas directement lié aux communautés palestiniennes ; son axe a toujours été l’Alexandrie hellénisée. Le déplacement vers la capitale impériale s’explique probablement par la recherche d’une plus grande stabilité politique, par des perspectives d’enseignement plus larges et par le désir de s’insérer dans la communauté chrétienne la plus influente du monde méditerranéen. L’Égypte souffrait de tensions économiques et de conflits locaux ; Rome, pour sa part, était le centre incontournable pour tout maître désireux d’un vaste rayonnement.
À son arrivée, Valentin s’intègre rapidement. Sous l’épiscopat d’Hygin (vers 136–140 apr. J.-C.) puis de Pie Ier (vers 140–154/155 apr. J.-C.), sa réputation croît au point d’attirer l’attention des plus grands écrivains chrétiens de l’époque. C’est Tertullien, le plus important théologien latin de la fin du IIᵉ et du début du IIIᵉ siècle — avocat africain de Carthage, connu pour son style féroce — qui affirme que Valentin fut considéré comme un candidat sérieux à l’épiscopat romain. Il ne le traite jamais comme un excentrique périphérique, mais comme quelqu’un qui, pendant un temps, fut “approuvé” dans la foi et jugé digne d’un grand crédit parmi les chrétiens.
Le “conclave” du IIᵉ siècle : l’élection qui écart a Valentin
L’élection épiscopale à Rome vers 140 apr. J.-C. ne ressemblait pas encore aux conclaves structurés de l’époque moderne, mais n’était pas non plus un improviste désordonné. Il s’agissait d’une assemblée où le collège des presbytres jouait un rôle central, avec la présence d’évêques des Églises voisines et la participation effective du peuple chrétien. L’acclamation populaire pouvait confirmer ou affaiblir un nom ; le choix possédait un fort caractère communautaire.
Le contexte était marqué par des persécutions périodiques. Cela signifie que, plus que l’érudition, comptait le témoignage de fidélité à l’Évangile sous l’épreuve. La figure du “confesseur”, celui qui avait été emprisonné, interrogé ou flagellé à cause de la foi, jouissait d’un immense prestige. Dans bien des cas, l’expérience de la prison pour le Christ valait davantage que tout diplôme philosophique pour qualifier quelqu’un à l’épiscopat.
C’est dans ce cadre qu’apparaît Pie Ier, évêque de Rome entre 140 et 154/155 apr. J.-C. Les sources le décrivent comme un homme simple, pieux et profondément aimé. Son frère est identifié à Hermas, l’auteur du Pasteur d’Hermas, l’une des œuvres les plus lues du christianisme du IIᵉ siècle, au point d’être tenue pour quasi canonique dans plusieurs Églises. Eusèbe de Césarée, dans l’Histoire ecclésiastique (4,22), affirme que Pie Ier, ou quelqu’un de très proche de sa famille, fut emprisonné à cause de la foi. Dans une communauté marquée par le sang des martyrs, un tel “curriculum” pesait de manière décisive.
Irénée de Lyon (Adversus Haereses 3,4,3) et Eusèbe lui-même (HE 4,11 ; 5,24) sont explicites : Valentin “vint à Rome sous Hygin, fleurit sous Pie et y demeura jusqu’à Anicet”. Il arrive vers 138–140, lorsque l’épiscopat d’Hygin touche à sa fin. La seule élection à laquelle il aurait pu être envisagé est précisément la succession d’Hygin, qui eut lieu vers 140–142 apr. J.-C., au moment où Pie Ier est choisi.
Les sources qui mentionnent sa candidature, Adversus omnes haereses 4, attribué au Pseudo-Tertullien, et Adversus Valentinianos 4, de Tertullien, ne disent pas qu’il “concourut directement contre Pie”, mais qu’il “espérait être jugé digne de l’épiscopat romain” et fut écarté au profit d’un “confesseur enchaîné à cause de l’Évangile”. Tout indique que ce confesseur, d’une manière directe ou indirecte, est lié à la figure de Pie Ier. Le récit de la défaite de Valentin n’est pas une légende tardive forgée pour le diaboliser ; il surgit de deux traditions différentes et converge en un point : Valentin ne perdit pas faute de prestige ou de talent, mais parce que, dans ce contexte, l’expérience de la souffrance pour le Christ était considérée comme un critère décisif.
Après l’élection, Valentin n’abandonne pas l’Église. Il reste à Rome une quinzaine d’années, enseignant, prêchant et vivant au milieu des presbytres et des fidèles. Tertullien, dans De praescriptione haereticorum 30, affirme qu’il “crut d’abord à la doctrine catholique, dans l’Église de Rome, sous l’épiscopat d’Éleuthère”, et qu’il ne fut exclu que plus tard, à cause de sa “curiositas inquieta”, c’est-à-dire sa tendance à spéculer au-delà des limites reçues et à introduire des doctrines troublant la foi des frères. Il se dégage l’impression d’un processus graduel : Valentin demeure en communion, tout en commençant à développer un enseignement réservé, différencié, destiné à un cercle intérieur de disciples.
La théorie tripartite de Valentin
La défaite à l’élection épiscopale, vue par les Pères comme un tournant, coïncide avec la période où Valentin commence à formuler une théologie de plus en plus hiérarchique et élitiste. Selon les sources anciennes, c’est précisément après avoir été écarté qu’il organise de manière systématique la célèbre division de l’humanité en trois catégories : pneumatiques, psychiques et hyliques. Cette structure n’est pas simple exercice abstrait ; elle reconfigure l’idée même d’Église.
Dans la lecture patristique, cette tripartition fonctionne presque comme une réponse à l’échec. Si l’assemblée ne l’a pas choisi comme évêque, alors la véritable autorité spirituelle ne résiderait pas dans la communauté “psychique”, mais dans ce groupe restreint qui détient la connaissance secrète, la gnose. Dans ce schéma, la “vraie Église” est composée des pneumatiques ; l’Église visible n’est plus que le niveau inférieur de la réalité salvifique.
Les Pères interprètent ce geste comme une forme subtile — même si elle n’est pas entièrement consciente — de vengeance théologique. L’historiographie moderne, représentée par des auteurs tels que Quasten, Simonetti, Lampe, Markschies et Thomassen, se montre plus prudente : elle évite les réductions purement psychologiques, mais reconnaît que la chronologie et la logique du système rendent très plausible le lien entre la défaite et la formulation tripartite. Quoi qu’il en soit, un fait demeure : Valentin, connaissant de l’intérieur la vie et la structure de l’Église de Rome, propose un modèle alternatif qui réemploie le langage chrétien pour instaurer une aristocratie spirituelle.
La formation intellectuelle à Alexandrie
La formation de Valentin à Alexandrie, entre environ 120 et 135 apr. J.-C., est essentielle pour comprendre pourquoi sa pensée fut si séduisante. Alexandrie était alors l’un des centres intellectuels les plus importants du monde, une sorte de capitale de l’érudition hellénistique. Juifs de la diaspora, philosophes platoniciens, écoles stoïciennes et premiers maîtres chrétiens cherchant à articuler la foi avec la culture classique y coexistaient.
Philon d’Alexandrie, au Iᵉʳ siècle, avait déjà ouvert la voie en interprétant l’Ancien Testament avec des catégories platoniciennes et une forte tendance allégorique. Cette méthode marqua profondément la lecture biblique alexandrine. Irénée, dans Adversus Haereses 1,11,1, affirme que Valentin “vient de l’école gnostique alexandrine”, expression qui décrit moins une institution formelle qu’un ensemble de maîtres, de pratiques exégétiques et de présupposés philosophiques propres à la ville.
La proximité chronologique avec Basilide, autre grand nom du gnosticisme, illustre bien le climat intellectuel de l’époque. Basilide enseignait à Alexandrie entre 120 et 140 apr. J.-C. ; Valentin se forme durant cette même période. Irénée (1,24,1) et Clément d’Alexandrie (Stromates 7,7) citent les deux comme des représentants d’une même tendance gnostique. Leurs systèmes ne sont pas identiques, mais ils partagent langage et techniques : Basilide parle de 365 cieux ; Valentin, de 30 éons ; tous deux recourent à la numérologie et à une métaphysique émanationniste de fond platonicien. Il n’est pas nécessaire de supposer une relation directe de maître à disciple ; il suffit de reconnaître qu’ils respirent la même atmosphère religieuse, où exégèse biblique et spéculation philosophique cheminent ensemble.
Trois dons permettent de comprendre pourquoi Valentin devint si dangereux aux yeux de l’Église. D’abord, il était philosophe de haut niveau, familier de Platon — surtout du Timée —, des traditions pythagoriciennes et d’une théologie négative décrivant Dieu comme totalement transcendant, “au-dessus de tout nom et de toute compréhension”. Cela fascinait les chrétiens instruits qui désiraient une foi capable de dialoguer avec le meilleur de la philosophie.
Ensuite, il était poète. Tertullien, dans De carne Christi 17 et 20, conserve des fragments de ses psaumes, hymnes destinés aux communautés valentiniennes, qui alliaient beauté littéraire et doctrine gnostique. Enfin, il était prédicateur d’un charisme peu commun. Clément d’Alexandrie, qui n’avait aucune sympathie pour la doctrine valentinienne, reconnaît dans Stromates 4,13 que Valentin possédait une capacité d’expression et de persuasion extraordinaire, au point d’admettre que, s’il ne s’était pas égaré, il aurait été l’un des grands docteurs de l’Église.
Le résultat de cette combinaison est clair : pour les hommes et les femmes cultivés du IIᵉ siècle, Valentin offrait précisément ce qu’ils recherchaient. Sa proposition permettait de maintenir la fidélité à Platon, offrait une vision cosmologique “organisée” de l’univers, unissait foi, philosophie, poésie et liturgie, et promettait un salut “plus élevé” à ceux qui seraient admis dans le cercle des pneumatiques. Ce n’est pas un hasard si Irénée, Tertullien et Clément s’acharnent à le décrire comme un théologien brillant qui, en se détournant de la voie droite, entraîna avec lui de nombreux chrétiens intelligents et bien placés dans la société.
Une “école théologique”, non une simple secte
Beaucoup de groupes gnostiques restèrent marginaux, confinés dans des cercles fermés. Le valentinianisme choisit une autre voie. Dès le début, il prit la forme d’un réseau d’écoles théologiques dispersées dans l’Empire. Il ne s’agissait pas d’un assemblage informe d’individus isolés, mais d’un système avec maîtres reconnus, disciples, méthodes d’enseignement, terminologie commune et certaine unité doctrinale.
Il existait des noyaux valentiniens à Rome, Alexandrie, Antioche, Édesse et en Gaule. C’est à Lyon, en Gaule romaine, qu’Irénée les affrontera de la manière la plus directe. Cette dispersion ne signifiait pas désorganisation : on parlait de “l’école de Valentin” avec un véritable sentiment d’appartenance. Il y avait une branche orientale et une autre occidentale, mais toutes deux partageaient la même structure fondamentale de mythologie et d’anthropologie.
Dans la pratique liturgique, le mouvement fonctionnait également à deux niveaux. Extérieurement, sa vie religieuse se confondait avec celle de l’Église : les valentiniens participaient aux mêmes assemblées, entendaient les mêmes lectures, recevaient les mêmes sacrements et chantaient des hymnes très similaires. Pendant un temps, ils apparurent aux évêques comme de simples chrétiens portés à une spéculation plus “profonde”. Intérieurement, cependant, ils maintenaient des rencontres réservées, des rites propres et des instructions qui réinterprétaient les sacrements à la lumière de la gnose.
C’est dans ce contexte que l’anthropologie tripartite déjà mentionnée devient structurante. Pour ce courant, l’humanité se divise en trois “races” ou substances : pneumatique, psychique et hylique. Les pneumatiques, porteurs d’une étincelle provenant du Plérôme et liée au drame de Sophia, sont destinés, s’ils sont éveillés par la gnose, au retour assuré à la plénitude divine. Les psychiques, créés par le Démiurge, identifié au Dieu de l’Ancien Testament, peuvent être sauvés par la foi, les sacrements et les bonnes œuvres, mais leur salut est intermédiaire. La plupart des chrétiens ordinaires, évêques et martyrs compris, se trouveraient à ce niveau. Quant aux hyliques, entièrement enracinés dans la matière, ils sont voués à la destruction avec le cosmos.
Cette vision a des implications dévastatrices. Les valentiniens continuaient de s’asseoir sur les mêmes bancs que les “psychiques”, recevaient la même Eucharistie, mais croyaient être les seuls à en comprendre spirituellement la réalité. Lorsqu’un chrétien orthodoxe mourait, ils pouvaient louer sa vie, mais concluaient : il sera récompensé à un niveau inférieur ; nous, pneumatiques, allons plus loin. Tertullien, dans Adversus Valentinianos 29, tourne en dérision cette posture en disant qu’ils se considèrent comme les seuls parfaits et voient les autres comme des enfants dans la foi.
L’attrait irrésistible pour l’élite intellectuelle et sociale
Dès le début, le valentinianisme devient l’expression religieuse privilégiée d’une part significative de l’élite chrétienne. Femmes influentes, aristocrates cultivés et intellectuels de haut niveau circulent entre l’orthodoxie et l’école valentinienne. Ils recherchent une forme de christianisme qui dialogue avec la culture hellénistique sans perdre l’aura de révélation, et trouvent en Valentin et en ses disciples une synthèse séduisante.
Le cas de Flora, conservé par Épiphane dans le Panarion (33,3–7), est exemplaire. Flora, issue d’une famille de haut rang, se trouve partagée entre la foi catholique et le système valentinien. Ptolémée, disciple direct de Valentin, lui écrit une longue lettre, devenue un précieux document du christianisme primitif. Il y interprète l’Ancien Testament avec une exégèse allégorique raffinée, cite Platon et conduit Flora à accepter la structure valentinienne comme accès à un niveau supérieur de compréhension. Il s’agit, en vérité, de l’un des premiers exemples clairs de “proposition gnostique” adressée à une femme de l’élite.
Un autre épisode marquant est celui de Marcus, surnommé “le Mage”, décrit par Irénée dans Adversus Haereses 1,13. Marcus élaborait des rituels à forte charge symbolique : le plus célèbre est le “calice de prophétie”, dans lequel, après des invocations en grec, le vin changeait de couleur ou débordait, probablement grâce à quelque substance ajoutée. À la fin, il oignait les femmes d’une huile parfumée et proclamait : “Je te confère la grâce d’Achamoth.” Irénée raconte que de nombreuses matrones nobles et riches non seulement étaient fascinées, mais finançaient l’école. Certaines, plus tard, revenaient repentantes, confessant avoir été séduites autant par l’appareil rituel que par la promesse d’être élevées au cercle des pneumatiques.
Jérôme, dans De viris illustribus 56, cite encore le cas d’Ambroise, homme de noble origine et de grande richesse, qui, au début de sa vie chrétienne, adhéra au valentinianisme. Plus tard, il se convertit à la foi catholique et devint l’un des principaux bienfaiteurs d’Origène, finançant des équipes de tachygraphes et de copistes pour diffuser ses œuvres. L’ironie est évidente : un ex-valentinien riche en vient à soutenir précisément celui qui sera l’un des plus grands opposants aux lectures gnostiques des Écritures.
Tertullien, dans Adversus Valentinianos 11, déplore que l’on trouve parmi les valentiniens de nombreux nobles, des philosophes et des femmes très fortunées. Et des études comme celles de Peter Lampe, sur le christianisme romain du IIᵉ siècle, localisent les maisons-écoles valentiennes dans des quartiers élevés comme l’Aventin et le Cælius, zones de résidence aristocratique. Il ne s’agit donc pas d’un mouvement marginal : c’est un courant religieux dont l’implantation sociale est clairement définie.
La raison de cette fascination devient claire lorsque l’on considère ce que le valentinianisme offrait. Il permettait de conserver l’adhésion à Platon et à la culture classique sans renoncer au nom du Christ ; il offrait une distinction spirituelle, en affirmant que certains étaient des “pneumatiques” destinés au Plérôme, tandis que les autres chrétiens resteraient à un niveau intermédiaire ; et il impliquait des rituels à forte charge esthétique et symbolique. Au lieu d’exiger le renoncement au statut social, il relativisait l’ordre matériel lui-même : si le corps et le monde sont inférieurs par nature, la richesse n’est pas une priorité, mais elle n’est pas non plus un obstacle. L’expérience religieuse pouvait devenir sophistiquée, exclusive et cohérente avec la position sociale du fidèle.
On comprend ainsi que de nombreux évêques aient décrit le phénomène avec une pointe d’amertume : tandis que des martyrs anonymes versaient leur sang dans les arènes, des valentiniens fortunés, installés dans le confort, se considéraient comme déjà titulaires d’un “passeport spirituel” pour une sphère supérieure et regardaient les chrétiens ordinaires comme des âmes destinées seulement à un degré moindre de béatitude.
La tolérance initiale de l’Église : la “période grise” (140–165 apr. J.-C.)
Pendant environ vingt-cinq ans, entre le milieu de l’épiscopat de Pie Ier et le début de celui d’Anicet, les valentiniens circulèrent dans les communautés chrétiennes sans condamnation formelle. Cette “période grise” fut décisive : elle permit à l’école de se structurer, de former des disciples, de se répandre dans plusieurs centres urbains et de consolider son identité comme alternative interne.
Plusieurs raisons expliquent cette tolérance. La première est l’indistinction pratique déjà évoquée : comme le rappelle Irénée dans le préambule de l’Adversus Haereses, les valentiniens “se réunissent avec nous, parlent comme nous, observent nos coutumes et ne se distinguent ni par le vêtement ni par la nourriture”. En termes de vie communautaire, il n’y avait aucun signe visible immédiat de rupture.
La deuxième raison est la stratégie d’un enseignement à deux niveaux. Le contenu public, exotérique, pouvait être presque identique à la foi catholique. Les différences n’apparaissaient que dans l’instruction réservée aux “parfaits”, après un long temps de convivence. Épiphane, dans le Panarion (31,7,2), décrit cette pédagogie duale : il y a une catéchèse pour les débutants et une autre, très différente, pour ceux qui sont jugés mûrs. L’hérésie se développe ainsi “de l’intérieur”, camouflée sous des formes légitimes.
La troisième raison est le prestige intellectuel des principaux maîtres. Valentin, Ptolémée, Héracléon, Florin étaient vus comme des interprètes aigus des Écritures. Certains avaient un poids suffisant pour être envisagés pour l’épiscopat ; d’autres entretenaient de fortes relations avec des familles influentes. Jusque vers le milieu du IIᵉ siècle, il n’existait pas de structure ecclésiale suffisamment assurée pour affronter publiquement de telles figures sans provoquer des fractures encore plus graves.
Enfin, l’Église manquait encore d’instruments systématiques pour combattre les hérésies de façon organisée. Le premier grand traité contre toutes les hérésies, rédigé par Justin Martyr, est perdu. Ce n’est qu’avec Irénée, vers 180, qu’apparaît une œuvre ample, méthodologiquement cohérente, consacrée à exposer et à réfuter patiemment un système comme celui des valentiniens. Lorsque Irénée écrit, il montre clairement que la situation est déjà grave : les valentiniens sont présents dans divers centres, avec leur propre catéchèse, des liturgies parallèles et une littérature robuste.
Une production littéraire impressionnante
Le succès du valentinianisme ne s’explique pas seulement par des réseaux sociaux et un prestige personnel. Sa production littéraire fut, à bien des égards, supérieure à celle d’autres mouvements chrétiens de l’époque. Alors que des communautés orthodoxes copiaient des lettres apostoliques sur de petits rouleaux bon marché destinés à circuler discrètement, les valentiniens produisaient des codex bien reliés, des textes soigneusement composés et des hymnes de grande qualité poétique. Le combat n’était pas seulement doctrinal, mais aussi esthétique.
L’Évangile de la Vérité, probablement écrit par Valentin lui-même entre 140 et 160 apr. J.-C., en est un exemple paradigmatique. Irénée rapporte qu’il était lu dans les assemblées valentiennes comme s’il s’agissait de l’Écriture. Redécouvert à Nag Hammadi (Codex I), ce texte est une méditation poétique sur le Prologue de Jean, présentant le Christ comme celui qui dissipe l’oubli et révèle le Père caché. Même ceux qui rejettent radicalement son contenu reconnaissent la puissance littéraire de l’écrit.
L’Évangile de Philippe, également conservé à Nag Hammadi, rassemble des paroles et des réflexions sur les sacrements, avec un accent particulier sur le thème de la “chambre nuptiale”, expression symbolique de l’union de l’âme pneumatique avec le Christ éonique. Ses phrases énigmatiques ont nourri, durant des siècles, des imaginations ésotériques et suscitent encore aujourd’hui de multiples interprétations.
Le Traité tripartite est le texte valentinien le plus long de la collection de Nag Hammadi. Élaboré par l’école orientale, il offre un panorama complet de la cosmologie, de l’anthropologie et de la doctrine du salut valentiniennes. C’est un système complexe, cohérent, qui se veut une alternative pleinement articulée à la théologie catholique.
Dans le domaine exégétique, le commentaire d’Héracléon à l’Évangile de Jean mérite une mention particulière. Origène, le plus grand exégète de l’Antiquité chrétienne, le cite près de cinquante fois dans son propre Commentaire sur Jean, reconnaissant la qualité de ses analyses tout en les combattant. Cela suffit à montrer que l’école valentinienne possédait une stature intellectuelle qu’on ne pouvait ni ridiculiser ni ignorer.
On peut encore citer les Psaumes attribués à Valentin, conservés en partie par Tertullien, ainsi que la lettre déjà mentionnée de Ptolémée à Flora, modèle de prosélytisme raffiné combinant philosophie, exégèse et direction spirituelle. Ces textes révèlent une capacité rare de s’adresser à la sensibilité cultivée de l’élite, en offrant en retour une expérience religieuse enveloppante.
Ce n’est pas un détail insignifiant que les codex de Nag Hammadi qui ont préservé ces œuvres, produits au IVᵉ siècle, aient été reliés en cuir, soigneusement travaillés et renforcés. Un seul codex représentait un investissement élevé, probablement équivalent à de nombreux mois de salaire d’un travailleur. Cela indique qu’il existait des lecteurs prêts à consacrer des ressources considérables pour avoir accès à ce type de littérature.
En définitive, l’affrontement entre orthodoxie et valentinianisme au IIᵉ siècle fut à la fois théologique, spirituel, culturel et esthétique. D’un côté, un système qui offrait explications brillantes, livres beaux et chemin réservé aux “spirituels”. De l’autre, une Église qui consolidait encore sa doctrine, souvent avec des moyens matériels modestes, mais soutenue par le témoignage de fidèles prêts à donner leur vie, et par l’effort lent et patient d’évêques et de théologiens qui, comme Irénée, décidèrent d’affronter la séduction du système valentinien avec une argumentation claire et persévérante.