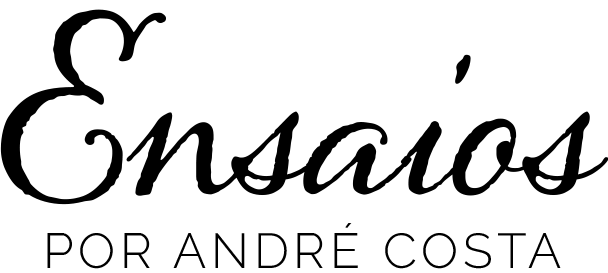Que ce soit dans les arts, la science, la vie professionnelle ou familiale, toutes nos actions partent du désir d’atteindre ce qui nous rend heureux. En d’autres termes, tout ce que fait l’être humain est, fût-ce de manière inconsciente, une recherche du bonheur. Parfois, ce bonheur réside dans l’acte même de chercher ; d’autres fois, dans le résultat obtenu. Chaque fois qu’il existe une finalité au-delà de l’action, cette fin est considérée comme plus élevée que l’action elle-même.
C’est dans cet horizon qu’Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, affirme : toute action humaine a un but, et la fin ultime de tous nos actes est le bonheur (eudaimonia). Pour lui, être heureux revient à bien vivre et à bien agir. À la différence des biens passagers comme l’argent, la santé ou la renommée, le bonheur est quelque chose d’absolu. Nous ne le cherchons pas comme un moyen en vue d’une autre conquête, mais pour lui-même. Il est le souverain bien, qui donne sens à tous nos choix et oriente la vie dans son ensemble. C’est pourquoi il consiste en une vie guidée par l’exercice de ce que nous avons de plus propre : la raison.
Il ne suffit pourtant pas d’avoir des moments heureux. Le bonheur exige toute une vie de bonnes actions, accompagnée de conditions minimales, comme la santé et des ressources de base, qui rendent possible la pratique de la vertu. Il ne peut être compris comme quelque chose d’immédiat ou d’éphémère : il requiert constance, effort et choix justes tout au long de l’existence. En ce sens, Aristote distingue les manières de comprendre le bonheur, montrant que tous n’en reconnaissent pas la véritable nature.
Comprendre ce qu’est le bonheur
Bien que tous s’accordent à dire que la finalité ultime de la vie est d’être heureux, tous ne comprennent pas le bonheur de la même manière. L’homme ordinaire tend à l’identifier à des plaisirs immédiats, à des richesses ou à des honneurs. Les sages, en revanche, perçoivent que le véritable bonheur ne se réduit pas à des biens passagers, mais doit être enraciné dans quelque chose de plus profond, capable de donner sens à tous les autres biens.
Pour éclairer cette différence, Aristote analyse les formes de vie auxquelles les hommes se consacrent. La vie de plaisir, la plus courante, recherche des jouissances immédiates telles que la nourriture, la boisson et le divertissement. Pour le philosophe, il s’agit d’une manière « bestiale » de vivre, car elle réduit l’homme au niveau de l’instinct, le privant de ce qui le distingue : la raison. Il y a aussi la vie politique, fondée sur l’honneur et la pratique de la vertu, plus élevée mais insuffisante, puisque l’honneur dépend de l’opinion d’autrui et que la vertu, à elle seule, ne suffit pas à assurer un bonheur plein face aux grandes infortunes. La vie de gain, centrée uniquement sur la richesse, est encore plus limitée, car l’argent n’est jamais une fin en soi, mais seulement un moyen en vue d’autres biens. Enfin, Aristote désigne la vie contemplative comme la plus élevée, car elle se fonde sur l’exercice de la raison. Dans celle-ci, l’homme se tourne vers ce qu’il a de plus propre et de plus noble, trouvant un bonheur qui ne dépend ni du hasard ni de l’approbation d’autrui, mais du travail intérieur et de la conformité de l’âme avec la vérité.
Le débat avec Platon
C’est précisément à partir de cette valorisation de la raison qu’Aristote s’éloigne de son maître. Platon défendait l’existence d’un Bien en soi, éternel et parfait, cause de tous les biens particuliers. Aristote en reconnaît la beauté, mais le juge insuffisant pour la vie pratique.
Selon lui, le terme « bien » s’emploie de multiples manières : il peut signifier l’opportunité dans le temps, le lieu adéquat dans l’espace, des vertus dans la qualité ou l’utilité dans la relation. Il n’est pas possible d’unifier tous ces sens en une seule essence abstraite. De plus, quand bien même il existerait un Bien universel, il serait inutile dans la vie concrète.
Un médecin ne guérit pas en contemplant l’Idée du Bien, mais en soignant un patient précis ; un général ne gagne pas des guerres en méditant sur le Bien en soi, mais en élaborant des stratégies pour ses troupes. Le véritable objet de l’éthique, dès lors, n’est pas un Bien lointain et abstrait, mais le bien humain réalisable, celui que nous pouvons chercher et concrétiser dans notre vie pratique.
Le bonheur et le destin humain
Aristote reconnaît que la fortune des descendants et des amis peut rejaillir sur un homme, mais seulement de manière faible. Si nous croyions que tout ce qui arrive aux autres affecte décisivement le bonheur de quelqu’un, nous tomberions dans l’absurde, car la vie est pleine d’innombrables événements impossibles à mesurer.
C’est pourquoi le bonheur d’une personne ne dépend pas de la fortune des autres : ce qui arrive aux amis peut avoir quelque effet, mais ne va pas jusqu’à ravir la béatitude des justes. Le bonheur, par conséquent, est stable et ne vacille pas au gré des oscillations externes.
Dans ce contexte, Aristote se demande si le bonheur doit être loué, comme le courage ou la justice, ou s’il occupe une catégorie supérieure. La louange, explique-t-il, est toujours relative à une action ou à une vertu ; le bonheur, pour sa part, n’est pas un moyen, mais une fin ultime. Nous ne disons donc pas que le bonheur doit être loué, mais qu’il est bienheureux. De même que nous appelons les dieux heureux, le bonheur est célébré comme quelque chose de divin et de parfait, source de tous les autres biens.
L’âme entre raison et désir
Si le bonheur est l’activité de l’âme conforme à la vertu parfaite, il est nécessaire de comprendre la structure même de l’âme. La politique, en ce sens, n’est pas seulement une technique du pouvoir, mais une science de la vertu, et requiert donc l’étude de l’âme.
Aristote y distingue une partie rationnelle et une autre irrationnelle. La partie irrationnelle se divise en deux : la végétative, liée à la nutrition et à la croissance, commune à tous les êtres vivants ; et l’appétitive, responsable des désirs et des passions, qui, bien qu’irrationnelle, peut obéir à la raison. C’est de cette obéissance que naissent les vertus morales, telles que la tempérance, le courage et la justice. Les vertus intellectuelles, comme la sagesse et l’intelligence, relèvent proprement de la partie rationnelle.
La vie humaine est donc marquée par cette tension entre raison et désir. L’homme intempérant se laisse dominer par les impulsions ; l’homme tempérant les éduque afin qu’elles se soumettent à la raison. De cette harmonie naît la vertu, et c’est dans la pratique de la vertu que l’âme trouve sa plénitude.
Entre hasard et vertu
Une autre question surgit alors : le bonheur est-il le fruit de l’apprentissage, de l’habitude ou d’un don divin ? Aristote admet que, si les dieux accordent quelque présent aux hommes, le bonheur serait assurément parmi les plus grands. Même ainsi, quand bien même il résulterait de la formation de l’âme et de l’exercice de la vertu, il demeure quelque chose de divin, puisqu’il constitue le prix et la fin ultime de la vie humaine.
Cela signifie que le bonheur n’est pas le privilège de quelques-uns. Quiconque, pourvu qu’il ne soit pas empêché de vivre vertueusement, peut l’atteindre par l’étude et la discipline. Il est plus noble d’être heureux par mérite que par hasard, car confier au hasard ce qu’il y a de plus élevé serait imparfait. C’est pourquoi le bonheur n’est pas la chance, mais la couronne de la vertu. Cette vision exclut les animaux et les enfants : ces derniers ne peuvent être dits heureux que de façon figurée, en raison de l’espérance placée en eux. Pour Aristote, le bonheur exige non seulement une vertu complète, mais aussi une vie complète, dans laquelle la constance de l’âme se vérifie au fil des vicissitudes du temps.
Conclusion
Aristote rejette à la fois les illusions vulgaires (plaisir, richesse, honneur) et l’abstraction platonicienne du Bien en soi. Pour lui, le véritable bonheur n’est pas un idéal lointain, mais un chemin possible, construit dans l’exercice de la raison et de la vertu. Il est l’activité rationnelle et vertueuse de l’âme, accompagnée de plaisir, suffisante en elle-même, mais soutenue par des conditions externes minimales.
Ainsi, le bonheur est le souverain bien qui donne unité et sens à toute la vie humaine, le destin vers lequel toutes nos actions, conscientes ou non, sont orientées.
Entre le plaisir et la vertu dans la littérature
Parler du bonheur, pour Aristote, c’est parler de la fin ultime de la vie humaine : ce qui donne sens à tous nos choix. Mais comment traduire en images une réflexion aussi dense ? La littérature, par sa force symbolique, offre des personnages qui mettent à nu, de manière vive, les chemins et les détours de la quête humaine du souverain bien. C’est pourquoi nous recourons à Alice, du classique Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et à Ulysse, l’Odysseus d’Homère dans l’Odyssée.
Ces deux personnages représentent des étapes distinctes de la relation de l’homme au bonheur. Alice symbolise l’immaturité de l’âme qui court après des plaisirs et des curiosités momentanés, toujours inquiète, sans clarté sur ce qu’elle cherche vraiment. Ulysse, au contraire, exprime la maturité de celui qui sait quel est son fin ultime, le retour à Ithaque, à sa famille, à sa maison, et qui maintient fermement ce dessein, même face aux tentations et aux souffrances.
En rapprochant ces deux histoires de la réflexion aristotélicienne, nous y trouvons plus que des aventures fantastiques ou mythologiques : nous y voyons reflétée la condition humaine elle-même. Alice et Ulysse nous aident à comprendre comment le plaisir, l’honneur, la vertu et, finalement, la contemplation s’articulent dans la recherche du bonheur. Ce sont des images littéraires qui éclairent la philosophie et rendent palpable ce qui, chez Aristote, pourrait paraître seulement abstrait.
La vie de plaisir vs la vie d’honneur
Aristote affirme que la vie de plaisir est la plus commune, mais aussi la plus basse, car elle réduit l’homme au niveau des instincts. C’est la vie de ceux qui vivent en quête de sensations momentanées, sans horizon de stabilité. Alice, chez Lewis Carroll, en est un portrait parfait. Ennuyée dans le monde réel, elle court après le Lapin Blanc en croyant trouver quelque chose de plus intéressant. Mais elle découvre un monde d’absurdités, rempli de fêtes dépourvues de sens, de banquets interminables et de personnages dominés par des passions déréglées.
Le « Thé des fous » représente bien la prison de l’immédiat : un cycle répétitif où l’on s’amuse sans véritable finalité. La Reine de Cœur incarne la tyrannie des passions, gouvernée par une colère irrationnelle, qui empêche toute orientation raisonnable. Le Lapin Blanc lui-même est l’image d’une quête anxieuse et instable, toujours en mouvement, mais sans parvenir nulle part.
Alice expérimente des plaisirs, vit des curiosités, mais demeure inquiète. Sa question constante — « Qui suis-je ? » — montre que le plaisir ne suffit pas, car il ne donne ni identité ni sens. Aristote dirait qu’Alice vit la vie de plaisir : une existence juvénile, immature, où la fin ultime n’a pas encore été reconnue.
À l’opposé, Aristote désigne la vie politique, fondée sur l’honneur et la vertu, comme plus élevée que le plaisir, mais encore insuffisante. Elle est propre à ceux qui recherchent reconnaissance et dignité, et Ulysse, le héros d’Homère, incarne bien ce chemin.
Tout au long de l’Odyssée, Ulysse est célébré pour sa ruse, son courage et son leadership. Il désire revenir à Ithaque non seulement par amour pour Pénélope et Télémaque, mais aussi pour reprendre sa royauté et restaurer l’ordre dans sa maison. L’honneur et le devoir guident sa route. À la différence d’Alice, qui court après plaisirs et curiosités, Ulysse garde clair son objectif. Il résiste aux Sirènes, refuse la promesse d’immortalité de Calypso, surmonte naufrages et combats, parce qu’il sait ce qu’il cherche : sa patrie, sa famille, sa dignité.
Cependant, Aristote avertit : la vie d’honneur n’est pas suffisante, car elle dépend du regard d’autrui et peut être ébranlée par la souffrance. Ulysse montre cette fragilité. Bien que vertueux et honorable, son bonheur n’est pas plein tant qu’il reste éloigné d’Ithaque, soumis au hasard de la mer et à la volonté des dieux. Sa vie est grandiose, mais instable.
La vie de gain : les faux biens en chemin
Une autre manière de vivre que critique Aristote est la vie de gain, celle qui réduit tout à la recherche de la richesse. L’argent, dit-il, n’est jamais une fin en soi, mais seulement un moyen.
Ici, Alice comme Ulysse offrent des images contrastées. Alice, en se laissant éblouir par des objets magiques, des gâteaux et des potions qui la font grandir ou rapetisser, montre combien les biens matériels peuvent être illusoires : utiles un instant, mais sans valeur durable. Ulysse, en refusant des banquets interminables et les présents de rois étrangers, montre que la véritable fin ne saurait se confondre avec des richesses accumulées. Chez Alice comme chez Ulysse, le message aristotélicien se confirme : les biens matériels sont transitoires et n’ont de sens que s’ils sont subordonnés à une fin plus haute.
La vie contemplative : le souverain bien
Aristote réserve le titre de vie la plus élevée à la contemplation rationnelle. En elle, l’homme se tourne vers ce qu’il a de plus propre : la raison. La contemplation n’est pas passivité, mais activité la plus pleine de l’âme, en harmonie avec la vérité.
Ni Alice ni Ulysse n’atteignent totalement ce stade, mais tous deux y pointent de manières différentes. Alice, dans sa confusion, entrevoit un éclair de contemplation lors de la rencontre avec la Chenille, quand on lui demande : « Qui es-tu ? ». Ce moment de pause et de réflexion rompt la course aux plaisirs et curiosités, introduisant le germe de la philosophie : la nécessité de se connaître et d’ordonner les désirs par la raison. Ulysse, pour sa part, incarne davantage cette dimension. Sa fidélité à Ithaque et sa constance face à la souffrance montrent qu’il a appris à distinguer moyens et fins, subordonnant les passions à un dessein supérieur.
La contemplation, toutefois, va au-delà de l’honneur et du retour. En termes aristotéliciens, elle est la vie où l’homme trouve la stabilité, non dans les opinions d’autrui ni dans des plaisirs éphémères, mais dans l’exercice continu de la raison, qui donne sens et unité à toutes les autres quêtes.
Entre Alice et Ulysse : immaturité et maturité de l’âme
Alice et Ulysse sont ainsi deux miroirs de la théorie aristotélicienne. Alice représente l’âme immature, perdue entre désirs et curiosités, toujours inquiète, sans clarté sur le souverain bien. Ulysse, en revanche, représente l’âme mûre, qui sait ce qu’elle cherche et maintient ferme son dessein, même au milieu des naufrages et des tentations.
Aristote dirait que la différence entre eux réside dans l’éducation des habitudes. Celui qui vit au gré des passions, comme Alice, n’a pas de base pour comprendre ce qui est juste et noble. Celui qui, comme Ulysse, a appris à discipliner les désirs et à se laisser guider par la raison, trouve dans l’éthique un guide sûr pour atteindre le véritable bonheur.
C’est pourquoi Aristote conclut que le bonheur n’est pas un hasard, mais la couronne de la vertu. Il ne se trouve ni dans l’instabilité d’Alice ni seulement dans l’honneur d’Ulysse, mais dans la vie rationnelle et vertueuse qui unit constance et sagesse. Alice nous avertit du danger de la dispersion dans des plaisirs passagers ; Ulysse nous inspire par sa fidélité à une fin ultime. Mais c’est Aristote qui nous rappelle que le véritable bonheur ne se réalise que dans la contemplation, l’activité la plus haute de l’âme humaine, qui donne sens et unité à toute la vie.